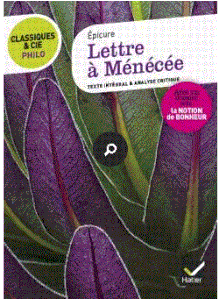- --- Accueil ---
- Révisions
- Découvrir la philo
- Exemples de dissertations
- Espace professeurs
- Textes
- Cours
- Methodes
- les différents types de plan
- Méthode explication de texte série générale
- Analyser les formes des sujets
- Conseils pour l'introduction
- Conseils 2
- Méthodes pour rechercher problématique
- Méthode explication de texte série technologique
- Méthode générale dissertation
- La morale
- L'histoire
- La justice et le droit
- Vit on en société que par intérêt ?
- La démonstration
- Le travail
- La conscience cours1
- L'inconscient
- Autrui
- Le temps
- Le désir
- Le langage
- La culture
- La nature
- L'art
- Le travail et la technique
- La technique
- La religion
- L'histoire
- La démonstration
- L'interprétation
- Le vivant
- La matière et l'esprit
- La vérité
- La société et les échnages
- La justice et le droit
- L'Etat
- La liberté
- Le devoir
- Le bonheur
- La raison
- Exercices
- Travaux des élèves
- Oeuvres
- Liens
- Etude d'oeuvre
- Ciné philo
- oraux du bac
- Nouvelle page
- Bibliographie
- L'année de philo
EPICURE - Lettre à Ménécée -
EPICURE
LETTRE A MENECEE
Traduction du grec par Marcel Conche
Epicure à Ménécée, salut.
§1 Que nul, étant jeune, ne tarde à philosopher, ni, vieux, ne se lasse de la philosophie. Car il n'est, pour personne, ni trop tôt ni trop tard, pour assurer la santé de l'âme. Celui qui dit ne le temps de philosopher n'est pas encore venu ou qu'il est passé est semblable à celui qui dit que le temps du bonheur n’est pas encore venu ou qu'il n'est plus. De sorte que, ont à philosopher et le jeune et le vieux, celui-ci pour que, vieillissant, il soit jeune en biens par la gratitude de ce qui a été, celui-là, pour que, jeune, il soit en même temps un ancien par son absence de crainte de l'avenir. Il faut donc méditer sur ce qui procure le bonheur, puisque, lui présent, nous avons tout, et, lui absent, nous faisons tout pour l'avoir.
§2 Ce que je te conseillais sans cesse, ces enseignements-là, mets-les en pratique et médite-les, en comprenant que ce sont là les éléments du bien vivre. En premier lieu, regardant le dieu comme un vivant incorruptible et bienheureux, conformément à la notion commune du dieu tracée en nous, ne lui attribue rien d’opposé à son incorruptibilité ni d'incompatible avec sa béatitude ; mais tout ce qui est capable de lui conserver la béatitude avec l'incorruptibilité, pense qu'il le possède. Car les dieux sont : en effet la connaissance qu'on en a est évidente. Mais ils ne sont pas tels que la foule se les représente ; car la foule ne garde pas intacte la notion qu'elle en a. L'impie n'est pas celui qui rejette les dieux de la foule, mais celui qui attache aux dieux les opinions de la foule. Car ce ne sont pas des prénotions mais des présomptions fausses que les assertions de la foule au sujet des dieux. A partir de là viennent des dieux les plus grands dommages et les plus grands avantages. Car, adonnés continuellement à leurs propres vertus, ils accueillent leurs semblables, considérant comme étranger tout ce qui n'est pas tel.
§3 Habitue-toi à penser que la mort n'est rien par rapport à nous ; car tout bien - et tout mal - est dans la sensation : or la mort est privation de sensation. Par suite la droite connaissance que la mort n'est rien par rapport à nous, rend joyeuse la condition mortelle de la vie, non en ajoutant un temps infini, mais en ôtant le désir de l'immortalité. Car il n'y a rien de redoutable dans la vie pour qui a vraiment compris qu'il n'y a rien de redoutable dans la non-vie. Sot est donc celui qui dit craindre la mort, non parce qu'il souffrira lorsqu'elle sera là, mais parce qu'il souffre de ce qu'elle doit arriver. Car ce dont la présence ne nous cause aucun trouble, à l'attendre fait souffrir pour rien. Ainsi le plus terrifiant des maux, la mort, n'est rien par rapport à nous, puisque, quand nous sommes, la mort n'est pas là, et, quand la mort est là, nous ne sommes plus. Elle n'est donc en rapport ni avec les vivants ni avec les morts, puisque, pour les uns, elle n'est pas, et que les autres ne sont plus. Mais la foule fuit la mort tantôt comme le plus grand des maux, tantôt comme la cessation des choses de la vie.
< Le sage, au contraire, > ne craint pas de ne pas vivre : car ni vivre ne lui pèse ni il ne considère comme un mal de ne pas vivre. Et comme il ne choisit pas du tout la nourriture la plus abondante mais la plus agréable, de même ce n'est pas le temps le plus long dont il jouit mais le plus agréable. Celui qui exhorte le jeune à bien vivre et le vieillard à bien mourir est niais, non seulement à cause de l'agrément de la vie, mais aussi parce que c'est une même étude que celle de bien vivre et celle de bien mourir. Bien pire encore celui qui dit qu'il est beau de « n'être pas né », mais, «si l'on naît, de franchir au plus tôt les portes de l'Hadès ». Car, s'il est convaincu de ce qu'il dit, comment se fait-il qu'il ne quitte pas la vie ? Cela est tout à fait en son pouvoir, s'il y est fermement décidé. Mais s'il plaisante, il montre de la frivolité en des choses qui n'en comportent pas.
§4 Il faut encore se rappeler que l'avenir n'est ni tout à fait nôtre ni tout à fait non nôtre , afin que nous ne l'attendions pas à coup sûr comme devant être, ni n'en désespérions comme devant absolument ne pas être.
§5 Il faut, en outre, considérer que, parmi les désirs, les uns sont naturels, les autres vains, et que, parmi les désirs naturels, les uns sont nécessaires, les autres naturels seulement. Parmi les désirs nécessaires, les uns le sont pour le bonheur, les autres pour l'absence de souffrances du corps, les autres pour la vie même. En effet, une étude de ces désirs qui ne fasse pas fausse route, sait rapporter tout choix et tout refus à la santé du corps et à l'absence de troubles de l'âme, puisque c'est là la fin de la vie bienheureuse. Car c'est pour cela que nous faisons tout : afin de ne pas souffrir et de n'être pas troublés. Une fois cet état réalisé en nous, toute la tempête de l'âme s'apaise, le vivant n'ayant plus à aller comme vers quelque chose qui lui manque, ni à chercher autre chose par quoi rendre complet le bien de l'âme et du corps. Alors, en effet, nous avons besoin du plaisir quand, par suite de sa non-présence, nous souffrons, < mais quand nous ne souffrons pas, > nous n'avons plus besoin du plaisir.
§6 Et c'est pourquoi nous disons que le plaisir est le principe et la fin de la vie bienheureuse. Car c'est lui que nous avons reconnu comme le bien premier et connaturel, c'est en lui que nous trouvons le principe de tout choix et de tout refus, et c'est à lui que nous aboutissons en jugeant tout bien d'après l'affection comme critère. Et parce que c'est là le bien premier et connaturel, pour cette raison aussi nous ne choisissons pas tout plaisir, mais il y a des cas où nous passons par-dessus de nombreux plaisirs, lorsqu'il en découle pour nous un désagrément plus grand ; et nous regardons beaucoup de douleurs comme valant mieux que des plaisirs quand, pour nous, un plaisir plus grand suit, pour avoir souffert longtemps. Tout plaisir donc, du fait qu'il a une nature appropriée < à la nôtre >, est un bien : tout plaisir, cependant, ne doit pas être choisi ; de même aussi toute douleur est un mal, mais toute douleur n'est pas telle qu'elle doive toujours être évitée. Cependant, c'est par la comparaison et l'examen des avantages et des désavantages qu'il convient de juger de tout cela. Car nous en usons, en certaines circonstances, avec le bien comme s'il était un mal, et avec le mal, inversement, comme s'il était un bien.
§7 Et nous regardons l'indépendance < à l'égard des choses extérieures > comme un grand bien, non pour que absolument nous vivions de peu, mais afin que, si nous n'avons pas beaucoup, nous nous contentions de peu, bien persuadés que ceux-là jouissent de l'abondance avec le plus de plaisir qui ont le moins besoin d'elle, et que tout ce qui est naturel est facile à se procurer, mais ce qui est vain difficile à obtenir. Les mets simples donnent un plaisir égal à celui d'un régime somptueux, une fois supprimée toute la douleur qui vient du besoin ; et du pain d'orge et de l'eau donnent le plaisir extrême, lorsqu'on les porte à sa bouche dans le besoin. L'habitude donc de régimes simples et non dispendieux est propre à parfaire la santé, rend l'homme actif dans les occupations nécessaires de la vie, nous met dans une meilleure disposition quand nous nous approchons, par intervalles, des nourritures coûteuses, et nous rend sans crainte devant la fortune.
§8 Quand donc nous disons que le plaisir est la fin, nous ne parlons pas des plaisirs des gens dissolus et de ceux qui résident dans la jouissance, comme le croient certains qui ignorent la doctrine, ou ne lui donnent pas leur accord ou l'interprètent mal, mais du fait, pour le corps, de ne pas souffrir, pour l'âme, de n'être pas troublée. Car ni les beuveries et les festins continuels, ni la jouissance des garçons et des femmes, ni celle des poissons et de tous les autres mets que porte une table somptueuse, n'engendrent la vie heureuse, mais le raisonnement sobre cherchant les causes de tout choix et de tout refus, et chassant les opinions par lesquelles le trouble le plus grand s'empare des âmes.
§9 Le principe de tout cela et le plus grand bien est la prudence. C'est pourquoi, plus précieuse même que la philosophie est la prudence, de laquelle proviennent toutes les autres vertus, car elle nous enseigne que l'on ne peut vivre avec plaisir sans vivre avec prudence, honnêteté et justice, < ni vivre avec prudence, honnêteté et justice > sans vivre avec plaisir. Les vertus sont, en effet, connaturelles avec le fait de vivre avec plaisir, et le fait de vivre avec plaisir en est inséparable.
§ 10 Qui, alors, estimes-tu supérieur à celui qui a sur les dieux des opinions pieuses , qui, à l'égard de la mort, est constamment sans crainte, qui s'est rendu compte de la fin de la nature, saisissant d'une part que la limite des biens est facile à atteindre et à se procurer, d'autre part que celle des maux est ou brève dans le temps ou légère en intensité, qui se < moque > de ce que certains présentent comme le maître de tout, < le destin, disant, lui, que certaines choses sont produites par la nécessité >, d'autres par le hasard, d'autres enfin par nous-mêmes, car il voit que la nécessité est irresponsable, le hasard instable, mais que notre volonté est sans maître, et qu'à elle s'attachent naturellement le blâme et son contraire (mieux vaudrait, en effet, suivre le mythe sur les dieux que de s'asservir au destin des physiciens : - car, avec l'un, se dessine l'espoir de fléchir les dieux en les honorant, mais l'autre ne comporte qu'une inflexible nécessité), qui ne regarde le hasard, ni comme un dieu, ainsi que la foule le considère (car rien n'est fait par un dieu d'une façon désordonnée), ni comme une cause inefficaces (car il ne croit pas que le bien et le mal, qui font la vie bienheureuse, soient donnés aux hommes par le hasard, mais pourtant qu'il leur fournit les éléments de grands biens et de grands maux), qui croit qu'il vaut mieux être infortuné en raisonnant bien que fortuné en raisonnant mal - le mieux, dans nos actions, étant de voir ce qui est bien jugé favorisé aussi par le hasard.
§ 11 Ces choses-là, donc, et celles qui leur sont apparentées, médite-les jour et nuit en toi-même et avec qui est semblable à toi, et jamais, ni en état de veille ni en songe, tu ne seras sérieusement troublé, mais tu vivras comme un dieu' parmi les hommes. Car il ne ressemble en rien à un vivant mortel, l'homme vivant dans des biens immortels.